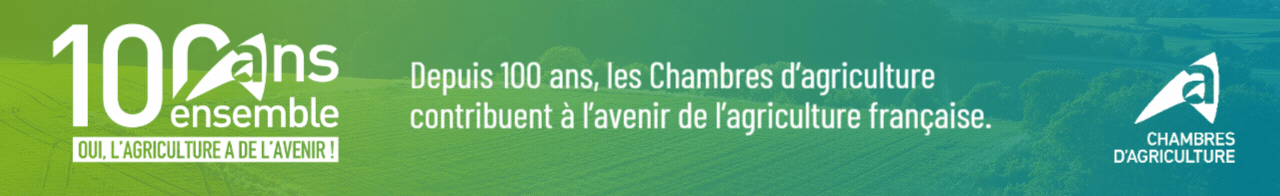
FLAVESCENCE DORÉE : la prospection, socle de la lutte

Si elle fait aujourd’hui l’objet de nombreuses attentions et d’une mobilisation des vignerons, coopérateurs, la flavescence dorée n’a pour autant pas disparu dans les départements viticoles de la région. C’est la surveillance du vignoble et le maintien de la prospection fine qui permettent de continuer de la contenir. En parallèle, les dispositifs de détection innovants par caméra infrarouge testés seront bientôt déployés.
La flavescence dorée reste une épée de Damoclès au-dessus de la tête des vignerons provençaux.
Chaque année, à partir de la mi-août, les prospections organisées par les services viticoles des Chambres d’agriculture, des coopératives, des pépiniéristes, sous la coordination de la Fredon et de la Draaf Paca, rappellent combien le risque est grand et nécessite une implication de tous. Mais le travail est ardu, mobilise les équipes, demande une formation... alors que les vendanges toujours plus précoces d’année en année, et attirent déjà à elles les bras vignerons.
Les professionnels l’ont bien compris, à l’image de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, qui a mis en place, il y a cinq ans désormais, un plan de lutte, comme ce qui se fait dans les autres départements. “La perspective d’un arrêt de la maladie n’est pas là, et il va malheureusement falloir vivre avec”, souligne Jean-Claude Pellegrin, président de la commission viticole de la Chambre d’agriculture 13. Mais “il ne faut pas pour autant que la lassitude s’installe face à ce fléau. Nous devons continuer de nous mobiliser pour organiser une prospection fine de l’ensemble de notre vignoble, afin d’éliminer les foyers présents”, insiste le vigneron.
Piégeage et prospection
Le premier pilier de la lutte reste le suivi des populations du vecteur, et c’est la Chambre d’agriculture qui gère ce plan de piégeage des cicadelles au stade adulte. “Ces piégeages, couplés avec les résultats de la campagne de prospection N-1, permettent d’établir des zonages définis par arrêté préfecto-ral, dans lesquels la lutte contre l’insecte vecteur peut-être obligatoire”, explique Sébastien Attias, le chef du pôle développement technique de la Chambre d’agriculture 13. D’où l’importance de l’effort de prospection et de surveillance du vignoble. C’est, là encore, les Chambres d’agriculture qui l’organisent. Avec l’équipe des conseillers viticoles et les encadrants embauchés, les Chambres délèguent une quinzaine de personnes par département et sur la durée de la campagne, des forces vives qui viennent appuyer les vignerons et leurs équipes.
Sur le terrain, un agent peut parcourir 20 à 25 km par jour environ. Ce qui permet de déterminer les surfaces à couvrir avec un nombre de personnes défini au préalable. La prospection s’organise ainsi, au fur et à mesure et en fonction du développement végétatif et de l’apparition des symptômes. “Au total, on mobilise à peu près 500 personnes sur un mois et demi environ pour la prospection du vignoble dans les Bouches-du-Rhône”, ajoute Sébastien Attias.
L'espoir de nouveaux outils de détection
Au fil des années la prospection fine, rang par rang, permet de contenir la maladie sur le territoire, voire de la faire régresser. C’est le meilleur signal que le travail collectif de prospection de la flavescence dorée puisse indiquer. “L’année dernière nous n’avons pas découvert de nouvelles zones contaminées et les seules concernées par la maladie se situent dans le nord des Bouches-du-Rhône. Nous avons détecté au total environ 1 000 pieds positifs confirmés sur 11 000 hectares de vignes”, rapporte Sébastien Attias. Dans le Vaucluse, la maladie reste très présente dans le vignoble, alors que des foyers sont apparus en 2019 dans le Var. Au final, en région, plus de 67 000 hectares (70 % du vignoble régional) étaient en périmètre de lutte obligatoire en 2019. La situation tend à s’améliorer progressivement dans les foyers historiques – secteurs Courthézon, Alpilles, sud Durance – mais la dissémination se poursuit autour de foyers plus récents (Enclave des Papes, nord-est Vaucluse, Luberon, Cabrières-d’Aigues : 2 parcelles à plus de 200 ceps d’après le communiqué du 29 septembre de la Draaf Paca). D’où l’importance d’accentuer l’implication des vignerons lors des prospections.
Le seul point d’inquiétude serait cette année un départ assez significatif et assez précoce sur la zone de la Camargue (certaines parcelles sont fortement atteintes, dont une à plus de 4 000 ceps). Les sorties des symptômes de la maladie sur le vignoble surviennent habituellement assez tôt dans la saison, vers la fin du mois d’août. Mais, cette année, des symptômes sont apparus très tôt en Camargue (début août), dans une zone où il n’avait jusqu’ici jamais été observé de flavescence, ni eu de suspicion. Au vu de la proximité du Gard, où la maladie est très présente, la situation ne surprend pas les viticulteurs du département. Heureusement, la filière pourra sans doute compter à l’avenir sur de nouveaux outils de détection de la maladie, suite aux travaux et expérimentations conduits par la Chambre d’agriculture.
Source : Agriculteur provençal : Emmanuel Delarue & Céline Zambujo
Des caméras infrarouges bientôt sur les vendangeuses Un dispositif de caméra infrarouge prometteur, conçu par la start-up RGX Systems, a été testé avec succès sur plusieurs campagnes déjà par la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. Embarqué sur les vendangeuses, ce capteur d’images noc- turnes cartographie les parcelles pendant la période des vendanges et restitue les données. De nouveaux essais étaient prévus cette année, pour affiner l’algorithme de traitement des couleurs et optimiser la localisation du GPS. La Chambre d’agriculture a obtenu l’autorisation par les services de la Draaf Paca de continuer l’expérimentation avec le dispositif. “Si les services de l’État valident les travaux cette année encore, on peut tout à fait imaginer passer à l’échelle supérieure, avec un équipement sur quelques machines l’année prochaine et commencer à commercialiser le produit rapidement”, indique Jean-Claude Pellegrin, président de la commission viticole de la Chambre d’agriculture 13. Le dispositif a d’ailleurs obtenu une belle reconnaissance, le prix de l’innovation de la Fondation Pierre Sarazin, qui sous l’égide de la Fondation de France, valorise la culture de l’innovation et de l’esprit d’entreprise du monde agricole et rural. |
A lire aussiEn savoir plus
Actualités en relation
> Prospection FLAVESCENCE DOREE : un bilan de campagne 2020 en demi teinte 12 novembre 2020> Viticulture : votre Info Viti du 6 octobre 06 octobre 2020


